La science ouverte aux PUSE
La « science ouverte » a pour but de diffuser en libre accès les résultats de la recherche, particulièrement lorsque celle-ci est financée par des fonds publics.
« Accessibles autant que possible et fermés autant que nécessaire »
Les Presses universitaires de Saint-Étienne travaillent depuis quelques années à la numérisation et la mise en ligne de leur contenus afin de correspondre à ces critères.
Tous nos ouvrages et revues répondent aux mêmes exigences d'expertise, au format papier comme numérique.
Nos livres
OpenEdition Books
Une collection en ligne : « Le XIXe siècle en représentation(s) »
Les ouvrages sont accessibles en accès freemium*.
Les nouveautés sont publiées simultanément en version papier et en ligne. Elles sont disponibles en accès exclusif** pendant une période de 12 mois, puis basculent en accès freemium.
Les livres de la collection sont toujours disponibles au format papier, disponibles en librairie ou par correspondance. Pour plus de détail, se référer à notre page « Le XIXe siècle en représentation(s) ».
La collection est sous licence CC BY-NC 4.0
La collection « Lire au présent » bientôt en ligne !
*Consultables en ligne en libre accès, mais non téléchargeables.
**Formats PDF et ePub payants téléchargeables en librairies électroniques ou disponibles pour les bibliothèques en ayant fait l’acquisition.
Persée
Projet en cours de numérisation des collections « L'École du genre » et « Des deux sexes et autres ».
Nos revues
OpenEdition Journals
Une revue en ligne : Focales
Créée en 2017, Focales est une revue qui a été pensée dès l'origine en accès libre. Elle a rejoint la plateforme OpenEdition Journals en 2022. Tous ses numéros sont en accès ouvert*.
La revue est sous licence CC BY-NC 4.0
*Consultables en ligne et téléchargeable gratuitement au format PDF.
Prairial
Une revue en ligne Droit Public et Comparé/Comparative Public Law
La revue est en accès ouvert sous licence CC BY-SA 4.0
Politique de publication et d'archivage
Tous nos publications sont soumises à des contrats d'édition, passés à titre sont non-exclusifs.
Nous autorisons le dépôt en archives ouvertes (type HAL) de la version auteur validée pour publication* 12 mois après la publication de l'ouvrage.
Plus d'informations sur nos contrats et procédures ici
*Version finale du manuscrit après révision par les pairs, accepté pour publication (≠ version éditeur).
Autres ressources
La feuille de route de la science ouverte à l'UJM ici
Le site Ouvrir la Science ! ici
Comprendre les licences Creative Commons ici

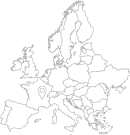 Université Jean Monnet
Université Jean Monnet